Ghislaine Souris – Rome
J’ai 20 ans quand j’entre dans la vie professionnelle et dans celle de jeune épouse. Cela me rappelle des années lumineuses. Depuis la 6èmè primaire, je sais que j’enseignerai. Mes motivations mûrissent avec les années. Je crois que le sens de la pédagogie me passionne toujours : faire passer un message, transmettre une façon d’appréhender une matière, une idée, un savoir. L’amour des enfants et l’intérêt réel que je porte à leur mentalité, leur milieu de vie, leur caractère, leurs aptitudes. Qui donc a dit ?: « Pour bien enseigner le latin à John, il faut d’abord connaître…John ! » C’est si juste.

Cet enthousiasme communicatif au long de trente années de carrière – je dirais plutôt de « vocation. » m’a toujours bien aidée. J’ai aussi beaucoup de patience. Expliquer plusieurs fois un point de la leçon, de façons différentes, calmement et même avec humour c’est un atout. La relation entre mes élèves – je dis mes enfants – et moi est basée sur la confiance, sur la complicité. Je leur demande gentiment mais fermement de « jouer le jeu » de ne pas économiser leurs efforts. Parfois un grand éclat de rire ponctue une réponse maladroite. Jamais de moquerie
Par exemple, à un cours d’histoire ancienne, j’explique que les Phéniciens et les Grecs de Phocée sont venus établir des comptoirs commerciaux – des colonies – à Marseille entre autres. Ce sont des colons. Silence étonné de la classe. Je demande :
« Qu’est ce que c’est les colons ? « J’insiste : » un colon ? » Toujours rien. Leur embarras me gagne. Soudain, une petite Dominique lève un bras triomphant :
« Bin, c’est un pigeon, hein dame. » Je ris, le fou rire se propage, ponctue cette réponse envolée tout droit du pigeonnier de son grand père.
Nous ne rions pas d’elle mais avec elle. Le respect de l’autre l’exige. De temps à autre, une grande fatigue m’envahit en fin de cours accompagnée le plus souvent du sentiment de réussite sur le plan professionnel et humain.
Toujours dans les fifties, au cours d’une réception de mariage, avec Clément ingénieur tout neuf à Espérance-Longdoz, des dames élégantes, plus âgées que moi, un peu snob, conversent allègrement:
« je fais du tennis » ou « je joue au golf. » « Nous nous retrouvons pour prendre le thé en ville, chez Bloch, rue pont d’Avroy » … Silencieuse j’écoute.
« Ne viendriez vous pas avec nous une après-midi ? » Poliment et avec le sourire, je réponds
« C’est un peu difficile pour le moment parce que je travaille » « Ah ! » Silence étonné, un peu guindé s’ensuit. Un supérieur hiérarchique de Clément me dit, condescendant : « Dans quel établissement travaillez-vous ?
« A l’école du Sacré-Cœur., à Flémalle-Haute»
« Tiens, c’est un milieu ouvrier, tout le monde est occupé aux Tubes de la Meuse ou à Phenix Works. C’est bien quand même d’avoir une fonction qui permette de « faire du social » dans un tel milieu » Je suis tellement outrée que je réponds :
« Je ne fais pas une bonne œuvre, Monsieur X. Je transmets des connaissances, un savoir faire qui permettent aux adolescents d’obtenir un diplôme et de travailler à leur tour et je suis rétribuée pour mon travail. Peut-être serez-vous bien avisé d’embaucher une secrétaire de notre petite école dans votre grande société d’ici 4 ou 5 ans. »
Et de tourner les talons, de me précipiter au buffet, d’avaler d’un trait une coupe de champagne pour noyer mon indignation.
Je tiens à parler aussi de mon travail à la maison qui ne se fait pas tout seul pendant que je suis à l’école ou que, à domicile, je ramène les cahiers à corriger et surtout les leçons à préparer. Non, elles ne sont pas élaborées une fois pour toutes. D’abord, on peut toujours améliorer, des idées neuves surgissent. L’inspection impose un autre livre de théorie ou d’exercices, un autre programme, une méthode nouvelle, une terminologie différente. Ce sera le cas pour la fameuse réforme de l’enseignement, le Rénové – qui devait faire merveille – alors que j’enseigne avec une méthode qui a fait ses preuves et dont les élèves manifestement ne souffrent pas trop et comprennent mes cours ce qui est confirmé par leurs résultats plus qu’honorables.
Donc à la maison, je travaille aussi ! Je n’aime pas quand on dit : « Je ne travaille pas ou je ne travaille plus » si on est femme au foyer. C’est dévaloriser les tâches ménagères, la gestion d’une maison, des enfants et encore plus sous estimer la maîtresse de maison. Elle doit aussi, dans les années cinquante-soixante du moins, seconder son mari dans sa carrière, recevoir sans s’écrouler de fatigue et être suffisamment décorative et disponible après sa double journée de travail, à l’extérieur et à la maison. En 1960 et presqu’encore pendant 10 ans, les cadres supérieurs de l’Espérance puis de Cockerill trouvent presqu’inconvenant qu’une femme d’ingénieur enseigne ou « travaille ». Est-ce que la société qui emploie le mari ne suffit pas à couvrir les dépenses du ménage ?

Quel est le matériel scolaire dans les fifties et encore après ? Le tableau noir, les craies et le « frotteur » pour effacer, exhalent une fine poussière calcaire. Ils imprègnent la salle de classe de leur odeur subtile, mélangée à celle de fins copeaux de bois tombés des taille-crayons
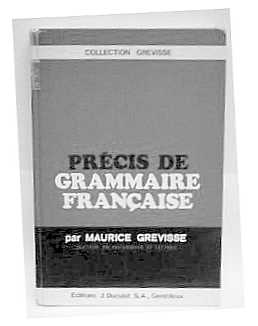
. Les livres de textes « Les bons auteurs », les exercices de grammaire de Grévisse et bien d’autres se succèdent. Ils sont progressivement remplacés par des feuilles manuscrites ou écrites à la machine, sur des stencils et sont reproduits par le polycopieur à encre, malpropre et difficile à manipuler qui permet toutefois de réaliser un grand nombre de copies. L’appareil à polycopier à alcool l’a remplacé. Il est plus maniable et permet de restituer des couleurs, le bleu, le vert et le rouge principalement. .La photocopieuse, plus tardive, serait-elle enfin l’outil idéal ? Elle reproduit docilement tout ce qu’on veut. Quel temps gagné de photocopier une carte géographique ou historique, une image, un schéma, un document ancien – en noir et blanc, il est vrai. Mais c’est un progrès indéniable.

Dans les classes de 1ère secondaire pourtant, l’incontournable tableau noir ou vert reste obligatoire car il doit présenter le titre précis de la leçon, les différentes étapes de la matière, la synthèse avec une écriture nette, lisible – ce qui contribue longtemps à déformer la mienne.
Une machine à calculer les résultats pour les bulletins mensuels est une aubaine. En voici une récupérée in extremis dans un carton destiné aux rebuts. Nous l’appelons «la petite machine Facit » (la marque est peu visible sur la photo) Il faut introduire les chiffres, tourner la manivelle pour chaque addition. Le calcul des moyennes nécessite des divisions et ce sont des opérations plus compliquées. C’est un objet de musée et je voue à cet instrument rudimentaire, une tendresse reconnaissante et nostalgique. Elle fait partie des objets usuels dans les années 50-60 jusqu’aux premières calculatrices de poche et les ordinateurs.

Je termine ce long commentaire relatif à l’école par l’évocation qui me tient à cœur le « Conseil de classe »
Il se tient presque tous les lundis, dans un local baptisé pompeusement « salle des professeurs ». Cette pièce comporte essentiellement de vieilles tables à dessus en formica rouge, usées par les ans, car elles proviennent de l’école à ses débuts. Les chaises d’où l’un ou l’autre clou perfide dépasse et déchire nos jupes, détricote nos pulls – j’exagère à peine – des armoires en fer, fermées avec nos clés personnelles, de style surplus américain. Une petite armoire de récupération avec un double percolateur bruyant car entartré, un évier et des essuies de vaisselle pour nos tasses et le café, car la salle sert aussi de cantine !
Quelle horreur ! pourrait-on dire ! C’est pourtant là notre repaire. Le fauteuil accueille nos coups de pompe. On corrige aussi nos cahiers, difficilement car cet endroit peu propice au travail est par contre le lieu privilégié de nos conversations, le refuge où on se confie nos peines, nos difficultés ponctuelles scolaires ou familiales et nos joies aussi. « De bric et de broc » la salle telle quelle, est par l’alchimie de tous ses composants un endroit privilégié que nous aimons tous et qu’on ne quitterait pas pour un autre. C’est un vrai lieu de vie, chaleureux dans son désordre ; avec son accueil merveilleux, il nous ressemble.
C’est aussi ce fameux conseil de classe qui « nous habite de l’intérieur ». Essentiellement constitué des titulaires de classes, il commence par la lecture du « cahier de communications ». Nous n’en prenons pas régulièrement connaissance, faut-il le dire, ce qui amène les premiers quiproquos. Nous sommes là chez nous, entre nous, rien de ce qui se dit ne passe la porte. On parle en confiance, avec authenticité, parfois avec des « engueulades », souvent des fous rires ; c’est notre défouloir parfois.
Notre amitié, notre esprit d’équipe se sont forgés là. Car sous un aspect un peu fou-fou, dans un joyeux pêle-mêle, le conseil de classe est sérieux. Chaque question, difficulté ou « petit bonheur », expérience sont partagés, accueillis avec respect et chaque suggestion retient notre attention, chaque décision est prise avec le maximum de réflexion, de bon sens, de chaleur humaine, de compétence. L’humour, la tolérance, la sincérité, nos coups de gueule, notre cafard parfois, …tout est mis en commun. On en sort avec optimisme, harassés parfois, réconfortés toujours. Riches de tout cela, pour rien au monde, nous n’aurions changé notre « polyvalente » salle des professeurs.
Le conseil de classe : au départ, une tâche professionnelle qui aurait pu se réduire à un simple travail administratif, s’est transformé en un temps fort de notre vie à l’école. Des amitiés se sont forgées, toujours présentes, car nous restons en contact et nous pouvons compter l’un sur l’autre dans les moments durs de la vie mais aussi quand nous partageons les petits et grands bonheurs de notre existence.
Cet état d’esprit existe-t-il encore, cinquante ans après ?
